L'homophilie oubliée de la société iranienne
L'homophilie oubliée de la société iranienne par Doug Ireland
 Pendant plus d'un millénaire, les Perses ont considéré les relations homosexuelles avec bienveillance. Répandus notamment à la cour et dans la bonne société, ces attachements étaient célébrés par la poésie classique et les traités sur l'art de gouverner. Une tradition rompue au XXe siècle, avec l'importation de la norme hétérosexuelle européenne, dont le régime Ahmadinejad est l'héritier inattendu.
Pendant plus d'un millénaire, les Perses ont considéré les relations homosexuelles avec bienveillance. Répandus notamment à la cour et dans la bonne société, ces attachements étaient célébrés par la poésie classique et les traités sur l'art de gouverner. Une tradition rompue au XXe siècle, avec l'importation de la norme hétérosexuelle européenne, dont le régime Ahmadinejad est l'héritier inattendu.
Quand Mahmoud Ahmadinejad affirma en septembre 2007, lors d'une intervention à l'université Columbia de New York, qu'« il n'y a pas d'homosexuels en Iran », l'absurdité de cette présomption a fait du président la risée du monde entier. Aujourd'hui, un livre écrit par une éminente universitaire iranienne en exil, Sexual Politics in Modern Iran, lui apporte la plus cinglante des répliques en exposant en détail la longue histoire de l'homosexualité en terre persane.
Consacrant une large partie de son ouvrage à l'Iran prémoderne, l'historienne Janet Afary présente la forme dominante de ces relations en termes d'« homosexualité définie par le rang ». Il s'agissait de liaisons particulièrement codifiées, où un homme mûr se procurait un partenaire plus jeune, l'amrad. Les « relations homo-érotiques masculines, écrit l'auteur, étaient régies en Iran par un véritable rituel courtois qui passait, pour l'aîné, par la distribution de cadeaux, l'enseignement de textes littéraires, la musculation et l'entraînement militaire, la guidance intellectuelle et l'exploitation de contacts sociaux susceptibles d'aider le partenaire plus jeune dans sa carrière ». Parfois, ces hommes échangeaient officiellement des vœux, les sigeh de fraternité (1). « Le sexe n'était pas l'unique raison d'être de ces relations, précise l'historienne. Il s'agissait aussi de cultiver l'affection entre les partenaires et de confier à l'homme certaines responsabilités quant à l'avenir du garçon. » Les "sigeh de sororité", concernant les pratiques lesbiennes, étaient également répandus.
Rien ne témoigne davantage des codes qui régissaient traditionnellement les relations entre personnes de même sexe, explique Afary, que « le genre littéraire du "miroir des princes" (andarz nameh) [qui] porte à la fois sur les amours homosexuelles et hétérosexuelles. Souvent écrits par des pères pour leurs fils ou par des vizirs pour leurs sultans, ces ouvrages consacraient des chapitres distincts au traitement des compagnons masculins et à celui des épouses (2). »
Dans l'un des plus célèbres d'entre eux, le Qâbâs Nâmeh (1082-1083), un père conseille ainsi à son fils : « Entre les femmes et les jeunes hommes, ne limite pas tes penchants à l'un ou l'autre sexe ; ainsi, les deux pourront te procurer du plaisir sans que l'un ou l'autre ne te devienne inamical. [...] L'été, oriente tes désirs vers les jeunes hommes, et l'hiver vers les femmes. » D'une manière générale, l'auteur rappelle à quel point les thèmes homosexuels émaillaient la littérature persane classique (XIIe-XVe siècles), via des allusions homo-érotiques passionnées ou même des références explicites à de jeunes et beaux garçons.
D'une manière générale, la société iranienne est restée, jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle et les premières années du XXe, « tolérante à l'égard de bien des pratiques homo-érotiques. [...] Les relations pédérastiques acceptées, à demi publiques, entre hommes adultes et amrads étaient monnaie courante dans différents milieux ». Apparue à l'âge classique, ce que Janet Afary appelle une « bisexualité romantique » était fréquente à la cour et dans l'élite : « Une forme d'amour intermittent (eshq-e mosalsal) était communément pratiquée, où l'affection pouvait osciller d'une fille à un garçon, et réciproquement. »
« Mais le pire scandale, rappelle l'historienne, concerna le simulacre de mariage organisé par deux jeunes hommes de la bonne société, liés à la cour. C'était la confirmation publique, surtout aux yeux des plus pieux, que la maison Pahlavi était pervertie par les pires mœurs et que le shah n'était plus maître chez lui. Ces rumeurs alimentèrent l'indignation populaire, et furent récupérées par les islamistes. »
 Peu après son accession au pouvoir en 1979, l'ayatollah Khomeyni instaura la peine de mort pour les homosexuels. Afary résume ainsi la situation de cette minorité sous Ahmadinejad : « Tandis que la charia exige soit les aveux en bonne et due forme des accusés, soit quatre témoins les ayant surpris en flagrant délit, les autorités actuelles ne recherchent que des preuves médicales de pénétration. Si elles les trouvent, la peine de mort est prononcée. Parce que les exécutions pour homosexualité ont soulevé des protestations à l'échelle internationale, l'État a généralement associé ces accusations à des charges de viol ou de pédophilie. Le recours permanent à cette tactique a encore ébranlé le statut de la communauté gay iranienne aux yeux de l'opinion. »
Peu après son accession au pouvoir en 1979, l'ayatollah Khomeyni instaura la peine de mort pour les homosexuels. Afary résume ainsi la situation de cette minorité sous Ahmadinejad : « Tandis que la charia exige soit les aveux en bonne et due forme des accusés, soit quatre témoins les ayant surpris en flagrant délit, les autorités actuelles ne recherchent que des preuves médicales de pénétration. Si elles les trouvent, la peine de mort est prononcée. Parce que les exécutions pour homosexualité ont soulevé des protestations à l'échelle internationale, l'État a généralement associé ces accusations à des charges de viol ou de pédophilie. Le recours permanent à cette tactique a encore ébranlé le statut de la communauté gay iranienne aux yeux de l'opinion. »
1. En Iran, le sigeh n'est pas l'apanage des homosexuels. Il s'agit d'une forme de mariage temporaire contrarié devant un mollah, pouvant durer de quelques heures (on la considère alors comme une sorte de prostitution) à 99 ans.
2. Ces manuels de conseil politique aux souverains sont apparus au Moyen Âge dans plusieurs civilisations mais, particulièrement répandus en terre d'islam, ils jouissaient d'une grande popularité en Iran. Ces opus sur l'art de bien gouverner, destinés à montrer au prince la voie à suivre pour régner selon la volonté de Dieu, traitaient à la fois des questions d'éthique personnelle, de la gestion de la maisonnée et de l'administration des sujets.
Extrait d'un article de Doug Ireland paru dans BOOKS numéro Spécial, History News Network, décembre 2011/janvier 2012 (Cet article est paru sur le site History News Network le 1er mars 2009. Il a été traduit par Béatrice Bocard)
 Quand Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ, toutes les conditions sont réunies pour faire de lui un homme accompli. Il hérite de son père, Philippe de Macédoine, l'énergie et la vigueur physique que complètent les dons de sa mère, son « enthousiasme pétulant et l'ardeur de sa sensibilité ».
Quand Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ, toutes les conditions sont réunies pour faire de lui un homme accompli. Il hérite de son père, Philippe de Macédoine, l'énergie et la vigueur physique que complètent les dons de sa mère, son « enthousiasme pétulant et l'ardeur de sa sensibilité ».
Son éducation intellectuelle est loin d'être négligée puisque son père la confie aux soins d'Aristote. Dès sa jeunesse, Alexandre n'éprouve que mépris pour « les plaisirs des sens ».
Quand Philippe meurt assassiné, Alexandre lui succède et devient à vingt ans roi de Macédoine. Il entreprend alors le grand œuvre de sa vie ; dix années durant, il découvre et conquiert un monde inconnu.
« L'action était pour Alexandre ce que la pensée était pour Aristote ». Son ambition de construire un immense empire riche de peuples et de cultures divers le conduit jusqu'en Inde, après avoir traversé et marqué de son empreinte l'Asie Mineure, la Syrie et l'Egypte.
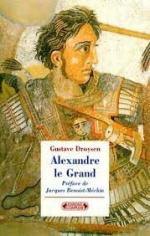 Alexandre se marie à Roxane, la fille d'un dignitaire vaincu, à la beauté légendaire. Ce mariage d'amour est aussi une union politique, un « symbole visible de cette interpénétration de l'Europe et de l'Asie qui n'était pas seulement, pour Alexandre, le fruit de ses victoires, mais la pierre d'angle de sa puissance ».
Alexandre se marie à Roxane, la fille d'un dignitaire vaincu, à la beauté légendaire. Ce mariage d'amour est aussi une union politique, un « symbole visible de cette interpénétration de l'Europe et de l'Asie qui n'était pas seulement, pour Alexandre, le fruit de ses victoires, mais la pierre d'angle de sa puissance ».
Gustave Droysen dit, en définitive, peu de choses de l'homme qu'était, en privé, Alexandre, « le plus grand héros » et « le plus jeune conquérant que le monde ait connu ». Il mentionne cependant, à la fin de son livre, l'amitié passionnée que portait Alexandre au « compagnon de ses jeux d'enfance », le bel Héphestion. Celui-ci éprouvait « un attachement touchant et illimité pour le roi ». Quand Héphestion meurt, Alexandre demeure prostré durant trois jours ; les funérailles qu'il organise pour son ami sont grandioses. Elles précèdent de quelques mois sa propre mort (en 323). « Il n'avait pas encore trente-trois ans ».
L'ample biographie que Gustave Droysen consacre à Alexandre le Grand parut, pour la première fois, en 1833. Son auteur avait vingt-cinq ans et inaugurait, avec ce livre superbe d'une grande qualité littéraire, une œuvre historique de première importance.
■ Editions Complexe, 1999, ISBN : 2870274130
Lire aussi : Moi, Alexandre, roi de Macédoine, fils de Zeus et conquérant du monde par Pierre Forni
 La pédérastie en vogue au sein de l'élite romaine de l'empire – qui se distinguait ainsi du républicain Cicéron – a connu un renouveau étrangement vivace à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les Uraniens, comme on les désignait en Angleterre, ont tenté, sous un masque de respectabilité, de reconstituer l'atmosphère pédérastique du temps de Platon, et le poète Stefan George a fait de même en Allemagne en créant le fameux cénacle qui honorait son « expérience » avec le jeune Maximin. Les Uraniens comptaient parmi eux le principal collectionneur d'œuvres érotiques grecques des temps modernes […] : l'Américain Edward Perry Warren, issu d'une riche famille de papetiers de Boston.
La pédérastie en vogue au sein de l'élite romaine de l'empire – qui se distinguait ainsi du républicain Cicéron – a connu un renouveau étrangement vivace à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les Uraniens, comme on les désignait en Angleterre, ont tenté, sous un masque de respectabilité, de reconstituer l'atmosphère pédérastique du temps de Platon, et le poète Stefan George a fait de même en Allemagne en créant le fameux cénacle qui honorait son « expérience » avec le jeune Maximin. Les Uraniens comptaient parmi eux le principal collectionneur d'œuvres érotiques grecques des temps modernes […] : l'Américain Edward Perry Warren, issu d'une riche famille de papetiers de Boston.
Une vie sexuelle bigarrée et inventive
Cette coupe, réalisée au Ier siècle, fut refoulée par la douane américaine au début des années 1950. Elle fut exposée pour la première fois en 2006 au British Museum.
Au début des années 1950, la coupe se vit refuser l'entrée aux États-Unis, pour cause d'immoralité, lors d'une vente des biens de Warren. Mais, dans les années 1990, elle fut reconnue comme un chef-d'œuvre, et le British Museum réunit 1,8 million de livres pour la garder en Grande-Bretagne. Elle a été exposée pour la première fois en 2006. L'omission d'une pièce aussi exceptionnelle reflète la négligence des auteurs envers l'art postclassique et les objets qui ne sont pas en céramique. La coupe de Warren, avec sa finesse d'exécution, nous emmène droit au cœur de l'univers hellénistique de l'Empire romain au milieu du Ier siècle de notre ère.
Les deux côtés de la coupe représentent un coït anal entre un homme et un garçon. Dans l'une des deux scènes, les amants n'ont qu'un faible écart d'âge, et le partenaire passif est assis à califourchon sur l'autre tout en se tenant à une sorte de courroie pour garder son équilibre. Dans l'autre, le garçon est nettement plus jeune, et il est étendu de côté sur les genoux du plus âgé. [Cette coupe] prouve qu'une scène de ce type pouvait être encore appréciée sur un objet de luxe des siècles plus tard.
Les spécialistes de l'Antiquité sont depuis longtemps attentifs aux attitudes des Grecs et des Romains à l'égard des rôles joués dans les rapports homosexuels. En règle générale, le partenaire actif ne voyait pas sa virilité dégradée, à la différence du partenaire passif. Cependant, il faut nuancer. Pour un garçon de moins de 18 ans, ou même un éphèbe entre 18 et 20, le rôle passif, s'il était consenti, faisait semble-t-il partie du processus d'apprentissage et n'avait pas d'incidence sur sa masculinité. Et la préférence pour le rapport intercrural qu'indiquent les vases classiques paraît une manière d'éviter une pénétration plus agressive, même si nous n'en serons jamais sûrs en l'absence de témoignage direct.
Nous ne saurons jamais non plus combien de ces liaisons se muaient en attachements à vie. Ce fut manifestement le cas pour certaines, mais probablement sans qu'elles conservent toujours leur dimension sexuelle. Nous savons également, grâce à Eschine, qu'un erastès pouvait passer sans problème d'un garçon à un autre sans encourir le moindre opprobre, à condition qu'il ne soit pas question d'argent. Pourtant, au cours des siècles tardifs, on voit des cités restreindre l'accès aux gymnases et protéger la jeunesse d'actes honteux. Puis nous découvrons la coupe Warren et la pédérastie affichée des empereurs romains. Cela au moment précis où Plutarque, qui était l'ami de tant des grands personnages de son temps, pouvait lancer son plaidoyer pour les joies de l'amour conjugal, tout en exposant avec sympathie celles de l'amour pédérastique.
La vie sexuelle des anciens Grecs était aussi bigarrée et inventive que leur culture resplendissante. Elle n'était ni cohérente ni uniforme. Aujourd'hui encore, elle résiste obstinément à toutes les idéologies et tous les préjugés modernes. Elle avait pourtant son propre code de décence. En matière de sexualité, comme dans tant d'autres domaines, les anciens Grecs étaient uniques.
James Davidson
Cet article est paru dans la New York Review of Books le 24 septembre 2009. Il a été traduit par Dominique Goy-Blanquet.
BOOKS numéro Spécial, décembre 2011-janvier 2012
 Une des premières doit être la température des pays chauds ; car, dans tous les climats brûlés par les ardeurs du soleil, on observe des passions violentes, et pourtant les femmes y ont moins de facilités de se rencontrer avec les hommes. Dans les pays froids, au contraire, les hommes sont beaucoup moins ardents, les femmes plus libres, les désirs plus modérés et par cela même facilement satisfaits. De prime abord, il semble difficile d'expliquer comment ces anciens philosophes, les hommes les plus sages de l'Antiquité, qui professaient les principes de la vertu la plus rigide, n'ont pu se soustraire à cette terrible contagion. La plupart, en effet, en ont été entachés. On peut dire que leur rigorisme même en est la cause. Regardant le commerce des femmes comme propre à amollir les caractères, et voulant, par orgueil, échapper à leur empire ; d'un autre côté, ne pouvant se soustraire aux influences du climat et aux exigences de la nature, trop faibles ou trop dépravés pour résister à la fougue de leurs désirs, ils les apaisaient par les moyens les plus honteux, et cela sous les apparences de l'austère vertu.
Une des premières doit être la température des pays chauds ; car, dans tous les climats brûlés par les ardeurs du soleil, on observe des passions violentes, et pourtant les femmes y ont moins de facilités de se rencontrer avec les hommes. Dans les pays froids, au contraire, les hommes sont beaucoup moins ardents, les femmes plus libres, les désirs plus modérés et par cela même facilement satisfaits. De prime abord, il semble difficile d'expliquer comment ces anciens philosophes, les hommes les plus sages de l'Antiquité, qui professaient les principes de la vertu la plus rigide, n'ont pu se soustraire à cette terrible contagion. La plupart, en effet, en ont été entachés. On peut dire que leur rigorisme même en est la cause. Regardant le commerce des femmes comme propre à amollir les caractères, et voulant, par orgueil, échapper à leur empire ; d'un autre côté, ne pouvant se soustraire aux influences du climat et aux exigences de la nature, trop faibles ou trop dépravés pour résister à la fougue de leurs désirs, ils les apaisaient par les moyens les plus honteux, et cela sous les apparences de l'austère vertu.
Souvent, sous le voile de l'amitié, se cachait la plus infâme turpitude. Les Anciens pensaient que ce commerce impur était un lien puissant pour enchaîner à jamais le cœur de deux amis, de la même façon que les jouissances rendent deux amants plus attachés l'un à l'autre. D'après cela, il serait peut-être permis de voir dans quelques-uns de ces modèles d'amitié que nous montre l'histoire autre chose qu'une affection pure et innocente. Le grand Achille, pleurant amèrement la mort de Patrocle, se trahit malgré lui dans sa douleur profonde lorsqu'il s'écrie :
Femorum tuorum sanctae consuetudinis
Quid pulchrius
L'abus des femmes amène la satiété et le dégoût ; la privation absolue laisse dans toute leur force les passions et les désirs non satisfaits, de sorte que deux voies opposées conduisent au même résultat. C'est pourquoi nous voyons souvent des pédérastes parmi ces grands viveurs qui ont passé toute leur jeunesse à se saturer, pour ainsi dire, de toutes les jouissances que les femmes sont capables de procurer à l'homme.
Nous en voyons encore parmi les marins, et malheureusement aussi dans une classe d'hommes qui ont fait vœu de chasteté, qui ont mission de prêcher la vertu par l'exemple.
La pédérastie et les autres passions contre nature sont portées, dans certaines villes de l'Inde, à un point tout à fait extraordinaire, et les Européens, à qui l'éducation morale a inspiré une véritable horreur pour ce vice dégradant, refusent souvent d'ajouter foi aux relations des voyageurs les plus véridiques.
Dictionnaire Larousse du XXe en 6 volumes - 1932
Ceux qui ont lu le journal de voyage de Victor Jacquemont, le sympathique et spirituel voyageur si malheureusement arrêté au milieu de sa courageuse carrière, doivent se rappeler que le vieux Runjet-Singh, qui occupait alors le trône de Lahore, se livrait sans le moindre scrupule à sa passion pour cet ordre de jouissance, passion que semblent d'ailleurs avoir partagée de tout temps tous les Seikhs. Il paraît même que Goulag-Singh, qui devint dans la suite vice-roi de Cachemire, du consentement et par le fait même des Anglais, et qui obtint une grande médaille pour ses cachemires à la première Exposition universelle, passait pour avoir servi dans sa jeunesse de mignon au vieux Lion du Pendjab. Un missionnaire contemporain raconte avec des exclamations de détresse et d'épouvante que, pouvant à peine croire à l'existence de tant d'abominations, il interrogea un jour le brahmane sur leur réalité. Loin de nier les faits, celui-ci les confirma avec complaisance et sans faire paraître qu'il désapprouvait ces turpitudes ; il semblait même s'amuser de l'embarras et de la confusion où la nature des questions qu'il était obligé de faire jetait le pauvre missionnaire :
— Comment, lui dit enfin celui-ci, dans un pays où l'union des deux sexes offre tant de facilités, comment peut-on concevoir qu'il existe des goûts qui ravalent l'homme fort au-dessous de la brute ?
— Sur cet article-là, répliqua le brahmane en éclatant de rire, chacun a son goût .
— Indigné de cette réponse saugrenue, continue le pudibond ministre de l'Evangile, et plein de mépris pour celui qui n'avait pas rougi de me la faire, je lui tournai immédiatement le dos...
Extrait du Larousse Universel du XIXe siècle
in Le Crapouillot n°58, printemps 1981, page 28
 Qu'on le déplore ou non, l'homosexualité n'est plus un thème tabou. Elle a sa presse, ses porte-drapeaux, et ses adeptes n'hésitent plus à s'afficher, bénéficiant désormais d'un peu de cette reconnaissance sociale à laquelle ils ont toujours aspiré. Depuis la Révolution, seul est délictuel l'attentat homosexuel sur la personne d'un mineur. Et avant ? L'auteur de « Les bûchers de Sodome » (Fayard) rappelle l'antique origine de la condamnation des « sodomites » et les phases alternées de répression et de tolérance de cette déviation aussi vieille que l'homme.
Qu'on le déplore ou non, l'homosexualité n'est plus un thème tabou. Elle a sa presse, ses porte-drapeaux, et ses adeptes n'hésitent plus à s'afficher, bénéficiant désormais d'un peu de cette reconnaissance sociale à laquelle ils ont toujours aspiré. Depuis la Révolution, seul est délictuel l'attentat homosexuel sur la personne d'un mineur. Et avant ? L'auteur de « Les bûchers de Sodome » (Fayard) rappelle l'antique origine de la condamnation des « sodomites » et les phases alternées de répression et de tolérance de cette déviation aussi vieille que l'homme.
La répression de l'homosexualité, telle qu'elle est exercée dans notre Occident judéo-chrétien jusqu'à une période récente, trouve son origine et sa justification dans le mythe de Sodome.
Le récit de la Genèse est clair : c'est parce que ce petit peuple de Chanaan pratiquait les mœurs contre nature que l'Eternel, faisant pleuvoir un torrent de soufre et de feu, anéantit la cité tout entière, avec ses habitants et le « germe de la terre ». Ce récit, qui a tant frappé les imaginations, servit pendant des millénaires à illustrer les lois fondamentales du Lévitique condamnant le crime de sodomie à la peine de mort :
« Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination » (Lév. XVIII, 22).
« Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une abomination. Ils seront punis de mort. Leur sang retombe sur eux. » (Lév. XX, 13).
Ce sont les textes fondateurs de la répression. La tradition judéo-chrétienne ne fera que les reprendre par la suite, en raffinant sur les supplices. Il va de soi que le souci de la natalité constituait la raison majeure de l'interdit : l'acte homosexuel pouvait, en effet, passer pour une trahison nationale au sein du petit peuple d'Israël, sans cesse menacé par de puissants voisins. Il en allait de même de la masturbation et de la bestialité. En fait, tout acte sexuel qui n'avait pas pour objet la procréation relevait du scandale et de l'impiété, car il mettait en péril l'existence même et la survie du peuple de Dieu.
Saint Paul réactualise le mythe de Sodome
Les récits évangéliques ne mentionnent pas l'homosexualité, et le Christ lui-même ne s'est jamais exprimé sur la question. Mais, comme il n'a cessé de proclamer son attachement à la loi mosaïque pour tout ce qui touche à la morale, on peut légitimement penser qu'il l'eût également suivie sur ce point, tout en recommandant d'user d'indulgence à l'égard des coupables.
Si l'on veut connaître les dispositions du Nouveau Testament à l'égard du péché contre nature, mieux vaut interroger son disciple saint Paul. Avec celui-ci, point d'ambiguïté : c'est la vieille hostilité rabbinique accommodée au goût chrétien, avec, en prime, le souffle de la fureur sacrée ; c'est la dénonciation violente de ces hommes qui, « abandonnant les rapports naturels, ont, dans leurs désirs, brûlés les uns pour les autres, commettant homme avec homme des actes infâmes et recevant en leur mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. » (Rom. I, 27) ; c'est l'exclusion tombant du haut de la chaire : « Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les pédérastes de tout genre n'hériteront du royaume de Dieu » (I Cor. VI, 9-10).
Dans leur grande majorité, les docteurs de l'Église ne feront que reprendre à leur compte l'interdit de la loi juive fondé sur la ruine de Sodome et réactualisé par saint Paul, Philon d'Alexandrie, Flavius Josèphe, ainsi que par des apocryphes du judaïsme tardif. Qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, ils réprouvent l'homosexualité avec la même horreur et ne conçoivent la relation sexuelle que dans son rapport à la reproduction de l'espèce. Ils développent, de surcroît, une vision délibérément négative du corps et de tout ce qui s'y rattache, jettent l'anathème non seulement sur les mœurs dites contre-nature, mais même sur la sexualité dite « normale », dès lors qu'elle s'écarte de l'impératif de la procréation, s'insurgeant contre la volupté des sens, condamnent le plaisir pour le plaisir.
Lorsque la chrétienté commence d'infiltrer le vaste Empire romain, celui-ci dispose déjà d'une loi contre le délit homosexuel. Promulguée en 226 avant l'ère chrétienne, la Lex scantinia prévoyait la relégation loin de Rome et de lourdes peines d'amende pour quiconque se rendait coupable de telles pratiques, en particulier sur la personne d'un enfant, mais cette loi était depuis longtemps tombée en désuétude. En conséquence, l'exemple prestigieux des Grecs aidant, la sodomie était si répandue à Rome que les adeptes de la religion nouvelle s'en servirent comme d'un puissant levier pour lutter contre le paganisme, seule cause, selon eux, de la décadence des mœurs. Au cours du IVe siècle, les premiers empereurs chrétiens n'hésitent pas à décréter la sodomie crime capital, inaugurant ainsi une ère de répression violente.
Homosexuels, hérétiques, tous des « bougres »
La première loi anti-homosexuelle de l'ère chrétienne fut promulguée en 342 par l'empereur Constantin II. Il semble, à lire sa conclusion, que le législateur n'ait pas osé heurter de front des usages enracinés par des siècles de tolérance, en condamnant les coupables à la peine de mort. Cette loi si vir nubit ne spécifie pas la peine, mais recommande curieusement des « supplices raffinés » (exquisitis poenis), sans même préciser lesquels. Un demi-siècle plus tard, l'Empire franchit un pas décisif dans la voie de la répression. Par un édit du 6 août 390, Théodose condamne les homosexuels au bûcher : « Tous ceux qui avilissent honteusement leur corps en le soumettant, comme des femmes, au désir d'un autre homme, et en s'adonnant ainsi à des relations sexuelles étranges, ceux-là doivent expier un tel crime dans les flammes vengeresses, à la vue de tout le peuple. »
La peine du feu rappelait, naturellement, le châtiment de Yahvé contre les habitants de Sodome ; mais elle avait également une signification purificatrice. Pour qu'il ne subsistât plus aucune trace de la souillure, les pièces du procès étaient jetées dans le bûcher, et les cendres du condamné dispersées au vent. En principe, celui-ci devait être brûlé vif ; néanmoins, la sentence comportait souvent un retentum autorisant le bourreau à étrangler sa victime, avant de la livrer aux flammes. Cette dernière opération se faisait dans le plus grand secret, afin de ne pas frustrer les assistants, qui se pressaient toujours nombreux aux exécutions, du principal attrait du spectacle. L'épaisse fumée qui s'élevait sur le lieu du supplice empêchait d'ailleurs de s'apercevoir de la supercherie. De cet usage vient l'expression : « N'y voir que du feu ».
Durant tout le Moyen Age, le crime de sodomie fut assimilé à l'hérésie religieuse. L'amalgame était si profondément enraciné dans les mentalités qu'un seul mot servit longtemps à désigner l'homosexuel et l'hérétique : bougre. A l'origine, ce mot qualifiait les membres de la secte manichéenne qui s'étaient réfugiés en Bulgarie, après avoir été chassés de l'Empire d'Orient, vers le Xe siècle. De Bulgare, on fit boulgre, puis bougre ; d'où le substantif bougrerie. Jusqu'au XVIIIe siècle, bougre avait, à la fois, le sens d'hérétique et d'homosexuel. Plus significatif encore de cette confusion : le terme hérite (forme ancienne pour hérétique), qui désignait couramment le sodomite au XIIIe siècle.
Compte tenu des immenses lacunes de nos archives en ces matières, on ne trouve aucune application des lois relatives à l'homosexualité avant le XIVe siècle. Mis à part un cas d'exécution capitale pour bestialité en 846, la première exécution par le feu parvenue à notre connaissance eut pour victime un certain Robert de Péronne, brûlé vif à Laon en 1317. Son frère, Jean de Péronne, accusé du même vice, fit également l'objet d'un jugement dont nous ignorons la sentence. En 1333, c'est un procureur et clerc de Paris, nommé Raymond Durant, qui se voit relégué dans un prieuré, tandis que ses deux valets et complices sont rendus à la liberté. L'année suivante, Pierre Porrier, de la ville de Dorche, monte sur le bûcher ; mais, en 1351, Guillaume Belleti n'est condamné qu'à une simple amende. L'absence d'information ne nous permet pas d'expliquer l'inégalité des sentences qui frappent les accusés laïcs. Quant aux religieux, ils jouissent d'un traitement de faveur, l'Église n'ayant pas le droit de prononcer la peine de mort.
En 1372, se déroula à Reims le premier procès d'un travesti. Il s'appelait Rémon et se faisait passer pour fille. Vêtu de longues robes traînantes, perché sur de hauts talons, fardé, frisé, paré de bijoux, il se livrait à tous les menus ouvrages de dames, fréquentait les commères de son quartier et portait avec elles son linge au lavoir. Tout le monde ne devait pourtant pas être dupe, car, une fois la nuit tombée, il allait vendre ses charmes aux portes de la ville. Un soir, qu'il racolait comme à son habitude, le long des remparts, il se fit accoster par un gentilhomme nommé Pierre de Cierges. Celui-ci, croyant avoir affaire à une fille, l'entraîne dans un champ voisin, le culbute à terre et se précipite sur lui, culottes baissées. L'autre alors, se met à crier, en se débattant : « Restez tranquille ! Que faites-vous ? Vous voyez bien que je suis un homme comme vous ! » Et, pour mieux le persuader, « lui montre son membre et nature d'homme dont il était garni ». Traduit en justice pour « péché de bougrerie et de sodomie » et pour avoir « habité charnellement avec plusieurs hommes dont il recevait profit, Rémon subit le supplice du feu, tandis que Pierre de Cierges, condamné au même sort en qualité de complice, fut exceptionnellement absous par le bailli du chapitre de Notre-Dame de Reims.
Gilles de Rais, le sommet du mal
Le procès de mœurs le plus retentissant du Moyen Age eut pour héros un monstre hors du commun, auprès duquel Néron lui-même ne fait figure que de sale gosse un peu pervers. L'histoire de Gilles de Rais est trop connue pour qu'il soit nécessaire de s'y attarder. Rappelons seulement que cet ancien compagnon d'armes de Jeanne d'Arc faisait enlever de jeunes enfants, du sexe mâle de préférence, les égorgeait de ses mains après les avoir violés, et souillait même leur cadavre après leur mort. Il gardait les plus jolies têtes pour les contempler à son aise et faisait brûler les corps dans la cheminée de sa chambre. On trouva une pleine citerne d'ossements calcinés dans la tour de Champtocé, de même que dans les latrines du château de la Suze, à Nantes, à Rais, à Tiffauges, à Machecoul... On évalue à plus de deux cents (six cents, voire huit cents, selon certains historiens) le nombre de ses petites victimes !
Traduit devant la Haute Cour de Bretagne, Gilles de Rais commença par nier énergiquement. Il récusa ses juges, mais il ne put récuser longtemps la foule des pauvres gens venus raconte avec force détails comment leurs enfants leur avaient été enlevés. Gilles s'effondra sous le poids de ces témoignages et des aveux de ses complices. Il versa des larmes abondantes et rédigea une confession complète de ses crimes qui demeure l'un des sommets de la « littérature du mal ». On y découvre une âme torturée, éprise d'absolu, altérée de pureté jusqu'à la boire dans le sang de ses victimes. Condamné au bûcher le 25 octobre 1440, il réclama un prêtre et mourut en priant Dieu. Un monument expiatoire fut élevé sur le lieu même du supplice. Par une curieuse ironie de l'Histoire, cet édifice, destiné à rappeler le châtiment du plus monstrueux infanticide de tous les temps, devint un lieu de pèlerinage pour les nourrices qui souhaitaient un lait abondant et généreux.
Il faut attendre la Renaissance italienne pour observer les premiers craquements dans le vieil interdit judéo-chrétien. C'est l'époque où Michel-Ange chante dans ses sonnets la rayonnante jeunesse de Tommaso Cavalieri, où Leonard de Vinci courtise les plus beaux élèves de son atelier, où Giovanni Bazzi tire vanité de son surnom du Sodoma, où Giovanni Della Casa dédie au pape Jules III son éloge en vers de la sodomie, où les débauches de Sixte IV défraient la chronique romaine...
Pontifes, princes, cardinaux, poètes, artistes, moines, banquiers, musiciens vouent à l'amour des garçons un culte comparable à celui qu'ils vouent à l'art et à la beauté. Avec la Renaissance, l'homosexualité devient un fait de culture, on pourrait presque dire une valeur esthétique, un raffinement indispensable, ou peu s'en faut, à quiconque aspire à la création. Comme s'il existait une sorte d'intelligence secrète entre le génie de l'artiste et la pratique des amours interdites.
Au lendemain des guerres d'Italie, la France fait la découverte éblouie de la Renaissance. La Cour devient italienne et l'italianisme règne sur l'élite : nobles, prélats, artistes, intellectuels ne jurent plus que par Rome et Florence. Encouragée par ce snobisme, la sodomie prend chez nous le nom de « vice italien ».
Pur produit de cette époque fascinante, Henri III en incarne à la fois toutes les contradictions et tout le mystère. Il en partage d'ailleurs les grandes obsessions esthétiques : ostentation, réversibilité, métamorphose, imagination fantasque. Fils de Sodome, il affiche son homophilie avec une audace qui frise la provocation. Les yeux noyés dans le fard, les lèvres peintes, la chevelure frisée au fer, il s'exhibe en public vêtu d'incroyables chausses de satin bouffant, cultive la parure avec des mollesses de courtisane et laisse ses chers Mignons prendre l'empire de son cœur et de son esprit, cherchant sans doute à compenser le précoce déclin de sa vigueur au contact de ces magnifiques adolescents.
Si la libération de l'homosexualité – ou plus souvent de la bisexualité – constitue l'une, des caractéristiques les plus spectaculaires de la Renaissance, précisons toutefois qu'elle n'aura profité qu'aux élites : le roi et sa cour, quelques hauts personnages, quelques artistes en renom... Mais, à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs du corps social, la répression montre à nouveau son hideux visage. Tandis que souffle sur la France le grand vent régénérateur venu d'au-delà des Alpes, le juriste Jean Imbert rappelle, du fond de son étroit cabinet, que le péché de sodomie est toujours passible de la peine du feu : « Nous pratiquons en France cette rigueur contre ceux qui sont convaincus de tel crime », note-t-il, au cas où on l'aurait oublié. Et de citer pour preuve le procès de Jean Moret, brûlé vif à Amiens le 13 décembre 1519.
Mais combien d'autres malheureux – des anonymes, pour la plupart – sont là pour témoigner que la Renaissance n'étendit pas uniformément ses bienfaits ! Tout au long du XVIe siècle, des commerçants, des prêtres, des artisans, des médecins, des enseignants, des hôteliers, des garçons de cabaret sont traînés devant les tribunaux, jugés, condamnés sur les dépositions de quelques vagues témoins – amoureux éconduits ou parents en quête d'indemnités – conduits sur le bûcher et brûlés vifs. Parmi eux, quelques femmes soupçonnées de lesbianisme ou surprises simplement en habit d'homme.
Si les procès de sodomie parvenus jusqu'à nous ne mentionnent que rarement le monde rural, cela ne veut pas dire que l'on vécût plus vertueux dans les campagnes que dans les villes ; simplement, le mode de vie très différent rendait pratiquement impossible la diffusion de l'amour socratique dans la France profonde. En revanche, la bestialité (considérée par les théologiens et les juristes comme une variante de la sodomie) y était largement pratiquée, à en juger par le nombre de laboureurs, vignerons, âniers, valets de ferme, charretiers, bergers, servantes qui furent périodiquement livrés aux flammes purificatrices (la bestialité était punie par le feu, comme la sodomie), toujours accompagnés de leur innocent complice à quatre pattes. Ces procès lèvent le voile sur l'un des aspects les moins connus de la misère sexuelle dans les campagnes.
A l'aube du XVIIe siècle, le royaume de France semble travaillé de l'intérieur par une intense fermentation religieuse : on établit l'obéissance, on resserre la discipline, on stimule la piété. Bref, on joue le jeu de la Contre-Réforme. La Cour se met à ressembler à une pécheresse repentie qui tâcherait de faire oublier ses excès passés en affectant la plus exacte dévotion. Le jeune Louis XIII se fait appeler « le Chaste », « le Juste », « le Pieux », mais parvient mal à dissimuler ses tendances les plus profondes. La fascination qu'exerceront sur lui Albert de Luynes, Barradas, Cinq-Mars, surtout, le plus violemment aimé de ses favoris, trahit en fait une homosexualité latente. Certaines indiscrétions commises par des intimes du souverain, comme Fontrailles, laisseraient même penser qu'elle fut pleinement réalisée. Moins exposés que Louis XIII, les princes du sang et les grands de la Cour pouvaient s'adonner plus librement à leurs penchants. A commencer par son propre frère, Gaston, et par son demi-frère César de Vendôme, dont le nom faisait souvent la rime à Sodome dans les pamphlets du temps. On sait aussi qu'Henri de Bourbon, prince de Condé, père du vainqueur de Rocroi (lequel héritera d'ailleurs de ses mœurs), draguait parmi le petit monde des collèges
; que le prince de Guéménée, d'une laideur proverbiale, taquinait ses pages ; que le maréchal de Guiche était surnommé « Ma Guiche » ; que le duc de Bellegarde ne devait sa fortune qu'à ses complaisances auprès de certains hommes influents ; que l'évêque d'Auxerre était fort épris d'un certain Chamarande, « porte-parasol » de Richelieu, ravissant jeune homme de dix-huit ans ; que Charles du Bellay, prince d'Yvetot, donnait plutôt dans la plèbe et payait (fort cher) de rudes gars du peuple.
On sait comment Monsieur, frère de Louis XIV, fut, dès sa plus tendre enfance, habité par le fantasme féminin ; il aimait à la folie les rubans, les dentelles et les parures. Il aurait bien souhaité s'habiller en femme, raconte son ami, l'abbé de Choisy, autre travesti notoire, « mais il n'osait à cause de sa dignité ». Seuls les bals masqués lui permettaient de réaliser son rêve : revêtir des robes de soie dont un garçonnet portait la traîne, se couvrir de falbalas et de bijoux. Pour peu que son cavalier lui infligeât les plus honteux affronts, comme il l'eût fait à une fille publique, ses transports ne connaissaient plus de bornes et ses sens s'embrasaient. Comme Monsieur, comme l'abbé de Choisy, Bernard de Crémeaux, abbé d'Entragues, issu d'une des meilleures maisons de France, appartenait, lui aussi, à la catégorie des hommes-femmes. Élevé comme une fille, il en garda toute sa vie l'accoutrement et le caractère. Mais il y avait plus grave que ces manies un peu ridicules, il est vrai, mais bien inoffensives.
Pouvait-on priver l'armée de ses plus brillants stratèges ?
En 1678, quelques jeunes seigneurs particulièrement hardis, le comte de Guiche, Gramont, Biran, Tallard, Tilladet, neveu de Louvois, décident de fonder une société secrète dont les statuts prévoient l'abstinence totale à l'égard des femmes et le port d'un insigne représentant un homme foulant une femme aux pieds. En outre, chaque candidat à l'admission devait être « visité » par les quatre « grands prieurs ». La confrérie à peine fondée, les candidatures affluèrent. Princes du sang, et gentilshommes se pressaient pour en faire partie. Parmi les premiers figurait le comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de Louise de Lavallière, bientôt suivi par le jeune prince de Conti, neveu du Grand Condé (famille décidément prédestinée). Louis XIV, qui haïssait ces sortes de débauches, résolut de faire des exemples. Il convoqua d'abord son fils Vermandois, le fit fouetter en sa présence, puis l'exila. Conti fut envoyé en résidence forcée dans sa famille à Chantilly et perdit à tout jamais la faveur du souverain. Bravant ces mesures, nos jeunes effrontés continuèrent de semer le scandale en maintes occasions, commettant des violences carrément criminelles.
Est-il besoin de dire qu'aucun d'eux ne passa en justice et que les flammes du bûcher les épargnèrent soigneusement. On se contenta de les tancer vertement et de les renvoyer dans leurs terres. On n'inquiéta pas davantage le maréchal-duc de Vendôme, petit-fils du précédent, qui fit la fortune d'Alberoni, parce que, selon Saint-Simon, celui-ci se jeta un jour à ses pieds et lui baisa le postérieur en s'écriant : « O culo di angelo ! » Nul n'ignorait pourtant que le maréchal payait ses palefreniers pour en faire ses amants. On ne prit non plus aucune mesure contre le maréchal d'Huxelles, ni contre le maréchal de Villars, ni contre le duc de La Ferté, ni contre le maréchal de Guiche, ni contre le maréchal de Gramont... Allait-on priver l'armée royale de ses plus brillants stratèges, sous prétexte que certains la confondaient avec le « Bataillon sacré » de Thèbes ?
Ces jeunes gens n'étaient d'ailleurs pas les seuls à se sentir au-dessus des lois. La pourpre aussi protégeait les siens, au moins autant que la cuirasse. De Jean de Bonzi, archevêque de Toulouse puis de Narbonne, au cardinal de Bouillon, qui s'affichait à Rome avec ses mignons, en passant par le cardinal de Coislin, prince-évêque de Metz, Hyacinthe Serroni, archevêque d'Albi, l'abbé d'Auvergne (de la famille de La Tour d'Auvergne), dont Saint-Simon disait : « Ses mœurs étaient publiquement connues pour être celles des Grecs, et son esprit pour ne leur ressembler en aucune sorte », la hiérarchie ecclésiastique abonde en disciples de Socrate. Sans compter certains prêtres de rang plus modeste, tel le spirituel abbé Servien qui mourut d'apoplexie entre les bras d'un danseur de l'Opéra.
Cependant, à la même époque, le bûcher continue d'éclairer la place de Grève de son sinistre rougeoiement. En décembre 1661, un couple de proxénètes, Chausson et Paulmier, est condamné à être brûlé vif, après avoir eu la langue coupée, pour avoir fourni de jeunes garçons à des grands seigneurs, non sans les avoir violés au préalable. L'année suivante, c'est au tour du poète Claude Le Petit de subir le même sort. Celui-là n'avait rien fait d'autre que de célébrer les mœurs contre nature dans des poésies libertines. Antoine Bouquet, exécuté le 26 août 1671, n'avait, lui non plus, à se reprocher que ses amours interdites. Même chose en province, pour laquelle nos archives nous livrent quantité de procès de sodomie qui trouvent leur issue dans les flammes. Leurs victimes sont, pour la plupart, des anonymes, sans naissance ni protections.
N'allons pourtant pas imaginer que les homosexuels se voyaient tous, sans exception, promis à ce funeste destin. Ceux-là ne constituaient même qu'une infime minorité et avaient en général à répondre de crimes plus graves : viols et rapts d'enfants, attentats meurtriers, etc. Les plus nombreux échappaient aux mains du bourreau, à condition toutefois de s'entourer de mille précautions. L'homosexuel de classe moyenne était condamné à la clandestinité, menacé à tout moment, sans cesse épié par ses voisins, et sentait peser sur lui des regards chargés d'opprobre, dès lors qu'il ne présentait pas les signes extérieurs de la morale bourgeoise : femme, enfants, foyers, horaires fixes, « bonnes fréquentations », assiduité aux offices... Malheur à qui ne dissimule pas ; la plus légère imprudence risque de le perdre. Au pis, ce sera le bûcher.
Au mieux, la prison, la maison de force, les galères, l'hôpital général, jugés encore préférables, certes, au flamboyant exorcisme de la place de Grève. A partir du XVIIIe siècle, les bûchers ne s'allument plus que de loin en loin : sept sodomites seulement sont brûlés avant la Révolution (le dernier en 1783). Le pouvoir semble avoir compris qu'en multipliant les exécutions publiques il risque d'aller à l'encontre du but recherché et de polariser l'attention sur un vice qu'il s'efforce, au contraire, d'éradiquer. D'autre part, la fin des bûchers marque une évolution capitale dans les rapports entre l'Église et le délit homosexuel. Le feu était, depuis les origines, le seul châtiment réclamé par le Ciel. Avec sa disparition, la connotation religieuse du crime se voit donc écartée et la condamnation portée par les tribunaux civils, tandis que le discours juridique, en retard comme toujours sur la pratique judiciaire, continue imperturbablement de vouer les sodomites aux flammes. Cette évolution se manifeste jusque dans le vocabulaire : on parle de moins en moins de sodomite (ce qui marque le rejet de la référence biblique), terme que l'on remplace par celui de pédéraste (surtout à partir des années 1730) et, plus souvent encore, par celui d'infâme. L'infâme, c'est le nom que porte désormais l'homosexuel dans le jargon de la police : [es procès-verbaux d'interpellation, les rapports de filature ne connaissent pratiquement plus que ce seul mot pour désigner leur proie. Pris en groupe, les infâmes font partie de la « manchette ».
Si la procédure criminelle a presque totalement disparu, c'est pour laisser place à une implacable répression policière. Tout au long du XVIIIe siècle, les lieutenants généraux de police, dont les pouvoirs sont désormais séparés de l'autorité judiciaire, vont tendre sur Paris un réseau de renseignements et d'observations aux mailles de plus en plus serrées.
La chasse aux « infâmes »
L'une des tâches essentielles de la police consiste à faire la chasse aux homosexuels et à la faune de gigolos, proxénètes, hôteliers, cabaretiers, truands de tout poil qui gravitent autour d'eux. Des exempts de robe courte sont particulièrement affectés à la filature et à l'arrestation des infâmes. Ils dépendent directement du lieutenant général et entretiennent à leurs frais des agents provocateurs, chargés de prendre les coupables en flagrant délit. On les appelle des « mouches ». Ils se recrutent le plus souvent parmi de jeunes prostitués ayant eu affaire à la justice. Une fois arrêtés, on leur laisse le choix entre la prison et la promesse de gratifications s'ils s'engagent à travailler pour la police. Au moindre faux pas, on les châtie sans pitié. Le rôle de la mouche consiste à se promener sur les lieux de drague, à se faire « raccrocher » par un promeneur, à l'amener à faire des propositions, si possible avec exhibition des « parties » ou attouchements. Point n'est besoin de recourir à l'acte : ces prémices suffisent à établir le flagrant délit. La mouche feint alors d'accepter et propose à son compagnon d'aller « boire chopine » au cabaret le plus proche. A peine ont-ils fait quelques pas que la mouche adresse un signe à l'exempt, dissimulé dans les parages avec ses hommes, et le quidam est aussitôt emmené devant le lieutenant général, qui l'interroge, le juge et décide de son sort.
Dans les cas les plus simples, s'il n'y a ni prostitution, ni violences, ni blasphèmes, et s'il s'agit d'une première arrestation, le prévenu est renvoyé chez lui. Avant de le relâcher, le lieutenant général lui adresse une réprimande, ce qu'on appelle une « mercuriale » et lui fait signer une « soumission » par laquelle il s'engage à ne plus fréquenter les promenades publiques. S'il s'agit d'un récidiviste, on le conduit en prison. La peine varie selon la condition du prévenu. En règle générale, un noble ou un fils de famille sont relâchés sur-le-champ, sauf si leurs frasques répétées risquent de mettre en péril la réputation de leur caste. Dans ce cas, ils risquent, au pire, de perdre leur charge et de se voir consignés à résidence sur leurs terres. S'il s'agit d'un ecclésiastique, le lieutenant général prévient aussitôt son supérieur hiérarchique – en général l'évêque de son diocèse – et le coupable se voit relégué au fond de quelque couvent de province. Pour tous les autres, la durée de la détention varie de huit jours à deux mois environ, mais peut se prolonger durant un an, voire plusieurs années, si la famille fait pression pour retarder la levée d'écrou ou paie la « pension » du prisonnier.
A partir de 1750 environ, se met en place un tarif dégressif des peines pouvant aller jusqu'à l'acquittement, selon les renseignements que le prévenu consent à donner à la police. C'est ainsi qu'un certain Jean-Louis, dit La France, domestique de son état, est remis en liberté en récompense de la longue déclaration par laquelle il a dénoncé tous les sodomites de sa connaissance. Quelques mois plus tard, le nommé Chatagnon, « faiseur de petits clous pour les gainiers », bénéficie de la même mesure. En marge du rapport le concernant, on peut lire cette mention : « On lui a fait grâce, à condition qu'il avouerait tous ses complices et tout ce qui était arrivé sur cet objet. » Beaucoup d'autres font comme lui et dénoncent ceux avec lesquels ils ont couché. Ainsi se constitue un véritable « fichier rose » du milieu gay, dont les archives de la Bastille conservent encore d'importants fragments.
En 1725 s'ouvrit à Paris l'un des plus retentissants procès de mœurs de l'Ancien Régime : l'affaire Deschauffours, qui allait trouver sa conclusion sur le bûcher, après un an d'une procédure particulièrement fertile en révélations et en coups de théâtre. On ne saurait la résumer en quelques lignes. Ce Deschauffours se livrait depuis des années, sous des noms différents, afin de brouiller les pistes, à un véritable trafic de jeunes garçons, qu'il vendait à de riches seigneurs français et étrangers. On découvrit, au cours de l'instruction, non seulement une ample traite d'enfants, mais d'autres crimes plus graves encore : Deschauffours avait commis plusieurs rapts et assassiné à coups de canne le fils d'un savetier âgé d'une dizaine d'années. Le 24 mai 1726, il fut conduit en place de Grève pour y être brûlé vif.
Dernier brûlé : le moine Pascal
Le dernier sodomite à subir la peine du feu fut un moine défroqué, du nom de Jacques-François Pascal, coupable lui aussi d'un attentat criminel sur un enfant, un petit commissionnaire de quatorze ans qui avait repoussé ses avances et qu'il avait lardé de dix-sept coups de couteau. Son exécution eut lieu le 10 octobre 1783 devant une assistance particulièrement nombreuse. Depuis le supplice de Damiens, on n'avait vu tant de monde envahir la place de Grève. Quant à l'enfant, il fut transporté d'urgence à l'Hôtel-Dieu, où il demeura longtemps entre la vie et la mort. C'est sur cette image d'un enfant sur un lit d'hôpital que s'achève l'histoire des bûchers de Sodome. Après Jean-François Pascal, on ne jettera pus personne dans les flammes pour cause de déviance sexuelle ; on ne condamnera plus jamais à mort pour cela. Pascal, il est vrai, avait agi comme le plus monstrueux des bourreaux et nul ne songerait à le plaindre. Peut-être même eût-on souhaité, pour finir, une vision moins hideuse que celle de l'enfance outragée. Pourtant, loin de remettre en question l'iniquité d'un châtiment qui frappait des individus dont le seul crime était de n'avoir pas les goûts de tout le monde, cette vision rejoint, par-delà de la mort, celle de ces hommes assassinés par des siècles d'intolérance et de barbarie.
Maurice Lever
Historama (Histoire Magazine) n°17, juillet 1985, pp. 36/43
 Cet ouvrage couvre la période allant de Louis XI à Henri IV. Emmanuel Le Roy Ladurie y trace un portrait d'Henri III : bon roi, mais pas homosexuel.
Cet ouvrage couvre la période allant de Louis XI à Henri IV. Emmanuel Le Roy Ladurie y trace un portrait d'Henri III : bon roi, mais pas homosexuel.
S'appuyant sur des travaux d'historiens (1), Emmanuel Le Roy Ladurie affirme que la prétendue homosexualité d'Henri III n'était que pure légende.
Ce roi, vrai "centriste" et modéré, obligé de naviguer à vue entre les réformistes protestants sur sa gauche et les ultra-catholiques de la Ligue menés par le duc de Guise sur sa droite, aurait été, en effet, la victime de basses attaques en tous genres qui, quatre siècles plus tard, entachent encore son image.
Succédant à Charles IX, en pleines guerres de religion, le fils de Catherine de Médicis n'aura certes pas réussi à calmer le jeu politique entre les huguenots et les guisards, mais il aura quand même rétabli un semblant d'autorité royale et mis en place les structures de l'Etat actuel. Les secrétaires d'Etat d'aujourd'hui, c'est lui.
Roi "cohabitationniste", Henri III aura été, au bout du compte, un bon monarque, ouvrant la voie à Henri IV et mourant poignardé, comme lui, en 1589, à l'âge de trente-huit ans, après quinze ans de règne.
Pour Le Roy Ladurie, c'est la haine qu'il inspirait aux puisards, principalement, qui lui vaudra de la part de ceux-ci les plus violentes accusations d'homosexualité : à une période où le culte de la virilité gauloise prédominait encore, quel plus beau chef d'accusation que celui-ci.
Pour Le Roy Ladurie, ces critiques s'expliquent cependant par un certain côté efféminé du personnage, par le fait qu'il aimait à se travestir. Amateur de parures, de fards et aussi de petits chiens, il pouvait déconcerter. Il reste que, pour l'historien, Henri III s'accordait en cela aux curiosités de son temps.
Et les mignons, alors ?
Les mignons étaient principalement des favoris. Henri, grâce à eux, voulait surtout tenir en respect les factions rivales de la sienne : celles de son frère François de France, duc d'Alençon, des Bourbon-Condé, des Montmorency et des Guise, les plus dangereux. Il s'entoure donc de jeunes hommes courageux, dévoués, coureurs de jupons, issus souvent de la moyenne noblesse ou noblesse seconde et il leur porte, en toute normalité, une tendre affection.
Une tendre affection qui le poussera à faire d'eux de très grands seigneurs et à les couvrir de cadeaux somptueux. A Anne de Joyeuse, son préféré avec Epernon, il donne la demi-sœur de sa femme, Louise de Lorraine, en mariage et à sa mort prématurée, inconsolable, lui offrira des funérailles royales.
Le Roy Ladurie estime que les mignons, terme ambigu mais déjà utilisé par des rois tout à fait hétéros pour désigner des hommes de leur proche entourage, n'étaient placés auprès du roi que pour le protéger, faire la guerre à sa place et lui remonter le moral, car Henri III était souvent dépressif. Selon l'auteur, si Henri III avait des tendances et qu'il a peut-être consommé en ce sens, il aimait les femmes et était marié.
Mais se marier, essayer de se guérir de son homosexualité ou tenter de soigner son image de marque est une chose que de nombreux homosexuels ont essayé de faire. Alors, quand on est roi, un roi très pieux, d'une piété sincère, extravertie, profonde, selon les mots de Le Roy Ladurie, et qu'on a l'obligation d'assurer la descendance...
Il faut rappeler qu'Henri III et sa femme n'ont pas eu d'enfants, laissant le pouvoir aux Bourbons.
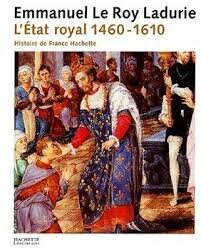 Pour Le Roy Ladurie, le fait intéressant n'est pas tellement qu'Henri III ait été ou non homosexuel, c'est l'émersion de ce thème dans la culture. On a peu attaqué les rois avant Henri III. Sauf Charles IX, à cause de la Saint-Barthélemy et Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, parce qu'elle était protestante, mais auparavant les rois étaient respectés. Or, ce thème émerge.
Pour Le Roy Ladurie, le fait intéressant n'est pas tellement qu'Henri III ait été ou non homosexuel, c'est l'émersion de ce thème dans la culture. On a peu attaqué les rois avant Henri III. Sauf Charles IX, à cause de la Saint-Barthélemy et Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, parce qu'elle était protestante, mais auparavant les rois étaient respectés. Or, ce thème émerge.
Est-ce à mettre en parallèle avec l'émergence des femmes dans la culture de la même époque ? On voit apparaître, en effet, autour d'Henri III, une sorte d'académie de femmes cultivées, qui annonce les "précieuses ridicules" que fustigera Molière au siècle suivant.
Plus que la prétendue homosexualité d'Henri III, c'est peut-être cette féminisation des mœurs, ce féminisme naissant, rompant avec le modèle viril des rois guerriers et chasseurs de jadis et des femmes soumises, qui sont stigmatisés par les libelles de la Ligue. Pour l'historien, cela pose le problème général de la calomnie. La Ligue a eu une telle capacité de diffamation qui a fait qu'Henri III, quatre siècles après, est toujours sous le coup de leurs calomnies.
Ce qui pourrait déformer un peu la vision historique des choses.
■ Editions Hachette/Histoire de France, 2003, ISBN : 201235730X
1. Notamment Henri III, roi shakespearien par Pierre Chevallier (Fayard) et La Cour d'Henri III par Jacqueline Boucher (Ouest-France).
Lire aussi : Henri III mort pour la France article de Jean-Yves Grenier (Libération)
 Est-ce sa rupture avec un ami, le prince d'Eulenburg, « mon meilleur ami», accusé d'homosexualité, qui poussa Guillaume II vers un pangermanisme violent ? Au début du siècle, l'Allemagne apparaissait à l'apogée de sa puissance et connaissait une véritable flambée nationaliste. L'empereur Guillaume II qui avait longtemps affiché des sentiments pacifistes fut conquis par les théories pangermanistes. Cette transformation semble coïncider avec un scandale de mœurs qui jeta l'opprobre sur un de ses amis soupçonné de mœurs contre nature.
Est-ce sa rupture avec un ami, le prince d'Eulenburg, « mon meilleur ami», accusé d'homosexualité, qui poussa Guillaume II vers un pangermanisme violent ? Au début du siècle, l'Allemagne apparaissait à l'apogée de sa puissance et connaissait une véritable flambée nationaliste. L'empereur Guillaume II qui avait longtemps affiché des sentiments pacifistes fut conquis par les théories pangermanistes. Cette transformation semble coïncider avec un scandale de mœurs qui jeta l'opprobre sur un de ses amis soupçonné de mœurs contre nature.
Un sexagénaire aux traits tirés, à la barbe grise, est étendu tout habillé sur un lit d'hôpital. Son cœur est fatigué, ses jambes enflées. En ce milieu de juillet 1908, la canicule écrase Berlin et l'atmosphère lui semble presque irrespirable. Assis non loin de lui, un magistrat le presse de questions. Un huissier introduit des témoins, les dépositions se succèdent.
Un procès se déroule, en effet, à l'hôpital de la Charité. Quelques jours plus tôt, l'inculpé a été transporté sur une civière devant le tribunal, mais son état s'étant aggravé, les médecins ont exigé qu'il soit ramené dans sa chambre. La justice, cependant a suivi son cours.
Entre deux interrogatoires, le malheureux ferme les yeux. Qui reconnaîtrait en ce vieil homme brisé le brillant prince d'Eulenburg, l'ami personnel du Kaiser, le représentant d'une illustre famille allemande ? Théoriquement, il est accusé de parjure et de faux témoignage, mais nul n'ignore qu'on lui reproche surtout des mœurs anormales. En ce début du XXe siècle, l'homosexualité, répandue dans l'armée et l'aristocratie, provoque l'indignation des vertueux Allemands. Dans les hautes sphères, délations et scandales se multiplient, éclaboussant souvent des innocents. Une sorte de chasse aux sorcières est ouverte.
Philipp-Frédéric Charles Alexandre Botho d'Eulenburg
Toujours naturel, jamais vulgaire. C'est « l'ami du roi »
Né en 1847, le comte Philip d'Eulenburg, que ses amis appelaient affectueusement « Phili », descendait par son père de toute une lignée d'officiers. Il tenait de sa mère, issue elle aussi d'une vieille famille, des goûts artistiques et littéraires. Avec ses livres rares et ses tableaux de prix, son château de Liebenberg, dans le Brandebourg, témoignait des goûts de la famille.
Entré dans l'armée pour satisfaire son père, « Phili » avait vite abandonné l'uniforme pour la diplomatie. En fait, il aimait surtout la musique et la poésie. Les ballades qu'il composait et chantait lui-même remportaient tous les suffrages. Elles lui vaudront le surnom, quelque peu péjoratif, de « comte troubadour ». Ses contes pour enfants, ses nouvelles lui apportaient également de grands succès.
De naturel affable, il connaissait l'art de plaire. A vingt-huit ans, il avait épousé une charmante Suédoise, Augusta de Sandels, qui lui avait donné huit enfants (deux moururent en bas âge). « J'ai rarement vu un aussi joli intérieur que chez Phili, sa femme l'adorait », écrira le chancelier Bülow.
Mais surtout, Eulenburg avait séduit l'empereur Guillaume II. Celui-ci n'était encore que prince héritier lorsqu'il rencontra Philip au cours d'une partie de chasse. Le soir, le comte d'Eulenburg se mit au piano et chanta une de ses romances. Guillaume, enthousiasmé, resta debout à ses côtés, tournant les pages de la partition et chantant à son tour.
Les deux hommes se revirent. Guillaume aimait recevoir chez lui le charmant poète, l'esthète raffiné. Il le présentait ainsi à son entourage :
— Philip d'Eulenburg, mon ami intime, mon meilleur ami.
De son côté, Eulenburg a raconté ses premiers entretiens avec le futur Kaiser : « Il aimait m'accueillir avec des citations de mes vers, lorsque nous nous rencontrions dans la forêt en ces matins de chasse... J'ai connu bien des auditeurs plongés dans l'enchantement, mais je n'ai presque jamais inspiré autant de ravissement qu'au prince Guillaume ! ».
Le ravissement continua lorsqu'en 1888, Guillaume ceignit la couronne impériale, « Lorsque Eulenburg arrivait dans notre foyer à Potsdam, c'était toujours un rayon de soleil dans la vie quotidienne », affirmera plus tard le Kaiser. Profondément cultivé, mais dénué de toute pédanterie, Phili amusait l'assistance par des anecdotes plaisantes. Il maniait l'ironie avec finesse, sans jamais blesser personne. On le savait d'une sensibilité frémissante ; le côté impressionnable de sa nature pouvait s'expliquer par une santé médiocre.
Guillaume II conviait régulièrement son ami aux croisières qu'il effectuait à la belle saison sur les côtes norvégiennes. Pour Philip, c'était là une corvée qu'il n'osait refuser. Il redoutait les lourdes plaisanteries, les fautes de goût des hauts personnages retrouvés à bord du yacht impérial. Mais le Kaiser ne pouvait se passer de sa présence.
Philip joua-t-il un rôle, peu après l'avènement de Guillaume II, dans le renvoi brutal de Bismarck ? Le vieux chancelier le crut ; son fils Herbert rompit alors avec Eulenburg – pourtant un ami de jeunesse – et lui garda une tenace rancune. Philip se rendait bien compte des ressentiments du chancelier disgracié. Il dit un jour à sa femme : « Personne ne savait haïr comme Bismarck. » Autour du vieil homme d'État, tout un clan partageait ses haines.
Le Kaiser, cependant, continuait à multiplier à son ami les témoignages d'estime. A plusieurs reprises, il lui offrit des portefeuilles de ministre, sagement refusés. Il le nomma prince, le décora de l'ordre de l'Aigle noir. En 1893, il lui donna à choisir entre trois ambassades : Londres, Vienne et Paris. Eulenburg préféra Vienne, plus proche de Berlin et où les problèmes diplomatiques semblaient moins difficiles à résoudre.
Bien que comblé, Philip jugeait avec clairvoyance les défauts du « pauvre et cher empereur ». Il connaissait sa versatilité, son incommensurable vanité, son goût immodéré, pour les manifestations grandioses et les proclamations ampoulées. « Il, (le Kaiser) aime la gloire, il est ambitieux et jaloux. Pour lui faire adopter une idée, il faut que cette idée ait l'air de venir de lui », expliquait l'ambassadeur à un proche.
On reprochera beaucoup à Eulenburg d'avoir trop flatté l'Empereur. Le vieux Bismarck, évidemment partial, s'offusquait déjà des « yeux adorateurs » avec lesquels le favori regardait son maître. Philip n'était évidemment pas homme à risquer son crédit pour tenter d'imposer une opinion. Cependant, il lui arrivait de dire quelques vérités au Kaiser. Il connaissait l'art d'envelopper ses critiques de considérations flatteuses. Guillaume remerciait son ami de sa sincérité : « Si tu ne me parlais à cœur ouvert, qui donc le ferait ?
En 1902, la santé chancelante de Philip l'obligea à abandonner son poste à Vienne. Il souffrait de bronchite, de rhumatismes articulaires, mais surtout ses tendances à la neurasthénie augmentaient. Guillaume II lui garda son amitié. Il continua à l'inviter sur son yacht et s'invita lui-même aux chasses de Liebenberg.
A cette époque, les complications internationales amenèrent de grands remous en Allemagne. En 1904, Berlin vit d'un très mauvais œil le rapprochement franco-anglais. Bien que petit-fils de la reine Victoria, Guillaume détestait le roi Edouard VII, son oncle. L'Entente cordiale ne pouvait lui plaire.
Les visées de la France sur le Maroc exaspéraient d'autre part les bellicistes allemands, à la tête desquels se trouvait le chef d'état-major Schlieffen et surtout le baron de Holstein, directeur politique des Affaires étrangères, en fait chef occulte du ministère depuis 1890. Ce personnage puissant et ténébreux nourrissait des sentiments passionnément gallophobes.
Pour couper court aux ambitions françaises, le gouvernement allemand – en particulier le chancelier Bernard de Bülow – poussa Guillaume II, qui n'y tenait guère, à se rendre à Tanger pour une spectaculaire démonstration de force. L'attitude menaçante de l'Allemagne dans l'affaire marocaine amena à Paris la démission forcée de notre ministre Delcassé, mais à la conférence internationale d'Algésiras, la France, soutenue par l'Angleterre, résista aux pressions allemandes.
Cette conférence fut jugée outre-Rhin comme un échec : l'acte final avait en effet reconnu « les intérêts spéciaux de la France au Maroc », et l'alliance franco-anglaise s'était resserrée.
Les Allemands bellicistes accusèrent alors Eulenburg d'avoir usé de son influence sur le Kaiser pour le pousser dans la voie de la conciliation. Eulenburg n'était pas particulièrement francophile, mais l'idée d'une guerre en Europe lui faisait horreur. Il essayait de réagir contre ce qu'il appelait « le monstrueux atavisme prussien Hohenzollern ». Partisan des compromis, il se faisait traiter d'« aristocrate sans ressort ». On lui reprochait en outre son goût pour le mysticisme et l'insolite. Le bruit courait qu'il avait mis Guillaume en contact avec un médium.
Parmi les personnages les plus hostiles au châtelain de Liebenberg se trouvait le conseiller Holstein qui, pourtant, s'était longtemps targué d'amitié pour Philip.
Fourbe, soupçonneux, susceptible, l'Éminence grise de la Wilhelmstrasse était un homme dangereux. Bismarck l'appelait « le serpent » ; Hohenlohe le comparait à une araignée. Pour le chancelier Bülow, « c'était un vrai Prussien » ; l'idée que la situation de la Prusse pouvait être amoindrie l'agitait jusqu'au plus profond de son être ». L'affaire marocaine ulcéra son chauvinisme exalté. Il trouva en Eulenburg un bouc émissaire.
Lire l'article complet de Bernard Boringe paru dans la revue Historia n°407, octobre 1980
 Que le lecteur ne s'égare pas : il ne s'agit nullement d'un livre léger et troublant, mais d'un travail scientifique mené par un spécialiste de la Rome antique. Ouvrage austère, mais grand public tout de même : les parties sont courtes et très structurées, la langue usuelle... ce qui permet à tout un chacun de mieux découvrir l'ancienne civilisation, où la nôtre plonge ses racines, sous un angle rarement abordé dans les classes secondaires ou en cours de latin.
Que le lecteur ne s'égare pas : il ne s'agit nullement d'un livre léger et troublant, mais d'un travail scientifique mené par un spécialiste de la Rome antique. Ouvrage austère, mais grand public tout de même : les parties sont courtes et très structurées, la langue usuelle... ce qui permet à tout un chacun de mieux découvrir l'ancienne civilisation, où la nôtre plonge ses racines, sous un angle rarement abordé dans les classes secondaires ou en cours de latin.
 Alexandre Parent-Duchâtelet rend compte, du vécu de la prostitution au XIXe siècle.
Alexandre Parent-Duchâtelet rend compte, du vécu de la prostitution au XIXe siècle.
Alain Corbin présente et annote une édition abrégée du texte original d'Alexandre Parent-Duchâtelet publié en 1836 sous le titre : « De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration... »
Parent-Duchâtelet, médecin hygiéniste et philanthrope, est « un des pionniers de la sociologie empirique ». Son livre, « d'abord un ouvrage sur la prostitution, non sur les prostituées » se veut « une somme, un modèle d'exhaustivité ».
Au terme d'une enquête de huit années et d'un énorme travail sur le terrain, ce spécialiste des égouts de Paris livre avec prudence et modestie le résultat de ses investigations.
Consacré exclusivement à la prostitution féminine, ce livre s'attache à en décrire les aspects quotidiens, administratifs et médicaux.
L'auteur, s'il évoque rapidement (pages 113 à 119) l'homosexualité féminine, au travers des « tribades », n'échappe pas pour autant aux préjugés anti-homosexuels de son temps.
■ texte présenté et annoté par Alain Corbin, « Editions du Seuil/Points Histoire », 2008, ISBN : 978-2757806913
Lire aussi : La prostitution antiphysique, François Carlier
 En marge du film Another Country, on peut illustrer l'histoire de quelques trahisons restées célèbres, mettant en scène des homosexuels. On peut aussi se demander pourquoi tout homosexuel a été considéré souvent comme un espion en puissance ?
En marge du film Another Country, on peut illustrer l'histoire de quelques trahisons restées célèbres, mettant en scène des homosexuels. On peut aussi se demander pourquoi tout homosexuel a été considéré souvent comme un espion en puissance ?
Alfred Redl était, dans les années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, colonel et chef du service des renseignements de la monarchie austro-hongroise, à Vienne. Il était aussi homosexuel, alors que l'homosexualité, considérée comme un crime, se voyait durement sanctionnée. Il nourrissait une tendre affection envers un garçon, l'officier Stefan Hromodka. Les services secrets russes allaient donc avoir barre sur lui, d'autant que des dettes anciennes et des besoins d'argent nouveaux le leur livraient. Découvert par ses pairs, Redl dut se suicider. Hromodka, qui n'avait jamais été mêlé à ses affaires d'espionnage, fut condamné par un tribunal militaire à trois mois de travaux forcés pour « crime de prostitution contre nature ». Le théâtre et le cinéma se sont emparés de cette affaire avec A patriot for me (Un bon patriote) de John Osborne et Colonel Redl, un film d'Istvan Szabo.
Sir Roger Casement (1864 – 1916) aimait trop les garçons et l'Irlande ! Il fut arrêté, au retour d'une mission en Allemagne, jugé, condamné à mort pour haute trahison au profit des Allemands et exécuté, le 3 août 1916. Georges V lui avait refusé sa grâce, après avoir lu des passages du journal intime de Sir Roger où l'homosexualité de celui-ci apparaissait clairement. Pour les Britanniques, Casement fut un traître ; pour les Irlandais, un patriote, et ses restes furent inhumés solennellement à Dublin en 1965.
Le groupe des espions de Cambridge (qui inspira Another Country), composé de Donald Mac Lean, Guy Burgess et Kim Philby est resté célèbre. Les origines sociales de Donald Mac Lean (une grande famille britannique et un père ministre libéral de l'Éducation nationale, au début des années 30) ne l'empêchèrent pas de fonder, avec quelques camarades, une société secrète « Les Apôtres », consacrée à la critique du capitalisme et à la défense du communisme. Les responsabilités assumées par ces hommes les mirent à même de fournir des renseignements précieux aux Soviétiques. En effet, Donald Mac Lean devint successivement attaché à l'ambassade de Paris (1938), premier secrétaire à Washington, chargé de la coopération américano-britannique en matière nucléaire (1944), conseiller au Caire (1948), chef du bureau américain du Foreign office (1950) et ce en dépit de ses excès de boisson et d'une dépression nerveuse au Caire. Guy Burgess fut, quant à lui, deuxième secrétaire à l'ambassade du Royaume-Uni, à Washington, lorsqu'il disparaît avec Mac Lean, en 1951, à la gare de Rennes. La fuite de la femme et des trois enfants de Mac Lean (eh oui !), en septembre 1953, confirme l'hypothèse d'un « passage à l'Est ». En 1956, Mac Lean s'installe à Moscou où il mourra le 6 mars 1984 (Burgess est mort en 63). Kim Philby (mort en 1988), a pu continuer d'espionner jusqu'en 1958 avant de rejoindre ses camarades de Cambridge à Moscou, en 1963, et d'obtenir la citoyenneté soviétique (n'avait-il pas dirigé le département russe au Foreign office ?).
En 1962, William Vassal, un fonctionnaire de l'amirauté britannique, est condamné à douze ans de prison pour avoir livré des documents secrets à l'Union soviétique. Les agents soviétiques, qui le surnommaient « Miss Mary », l'avaient photographié, à Moscou, avec trois hommes, pendant une partie fine, le contraignant de la sorte à céder au chantage à cause de la loi britannique punissant l'homosexualité. William Vassal a conseillé la BBC pour un feuilleton évoquant son arrestation, après sa libération conditionnelle intervenue en 1972.
En 1964, Sir Anthony Blunt, conseiller artistique de la reine et critique d'art réputé, passe aux aveux et bénéficie de l'impunité pour ses opérations d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale. L'affaire ne sera rendue publique qu'en 1979, par le gouvernement conservateur de Mme Thatcher, après la première édition du livre « Un climat de trahison » d'Andrew Boyle.
Y a-t-il dans l'activité d'espion la projection d'une crise d'identité, résultant d'une difficulté à se situer ? Quelles peuvent être pour un homosexuel les motivations à embrasser des carrières diplomatiques ? Faut-il incriminer le caractère néfaste des lois répressives et de l'ostracisme social qui fragilisent les individus face aux tentatives de chantage ?
Certains pensent que les autorités devraient aboutir à cette conclusion plutôt que de considérer les homosexuels comme personæ non gratæ. Faut-il d'ailleurs oublier les scandales qui ont impliqué des hétérosexuels (John Profumo en 1963) ? Cependant, il serait simpliste d'identifier toujours des histoires de trahison à des histoires d'homophobie. L'homosexualité renverse les tabous. Elle amène parfois l'individu à poser un regard critique sur les institutions, les systèmes, les structures, parce qu'il vit en lui-même la contradiction qui existe entre ses aspirations et la norme collective. L'homosexualité affaiblit donc la cohésion qui rattache l'individu au groupe, et ce n'est pas un hasard si les régimes totalitaires la réprouvent, qu'il s'agisse des théocraties, des fascismes ou des démocraties populaires... Certes, tout dépend à la fois des réactions individuelles et du degré d'intégration ou de ségrégation de l'homosexualité. Ainsi, il y a eu des homosexuels collaborateurs, des traîtres et des patriotes, des crapules et des héros ! Toute tentative de vouloir ranger les homosexuels dans un camp ou dans l'autre se heurte à la réalité des faits.
http://culture-et-debats.over-blog.com/categorie-92052.html








/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F76%2F920763%2F129836392.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F58%2F1321362%2F128077450_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F74%2F1321362%2F104485794_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F54%2F1321362%2F104493666_o.jpg)